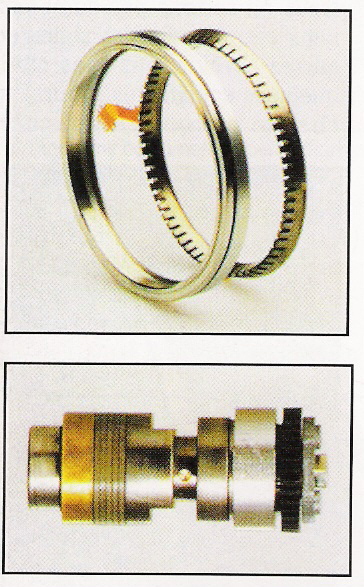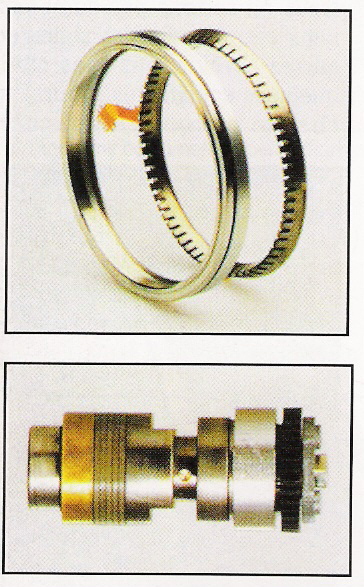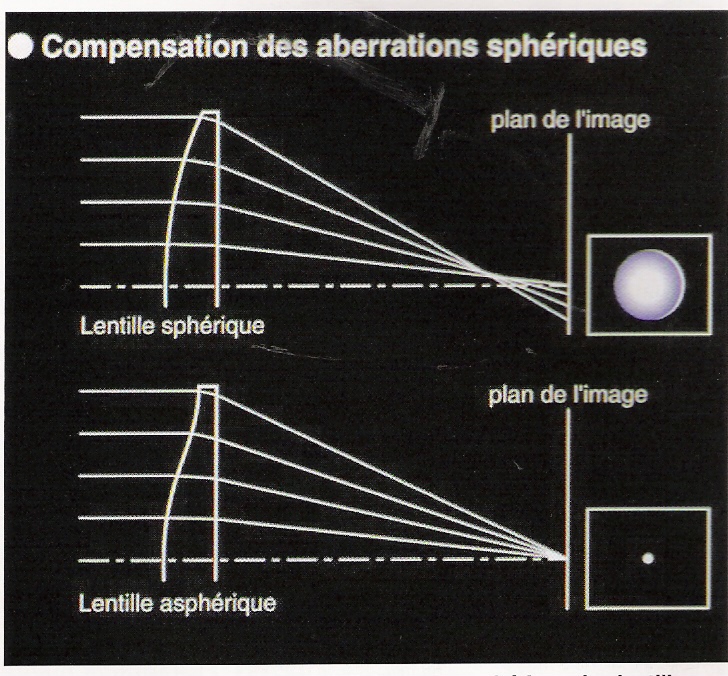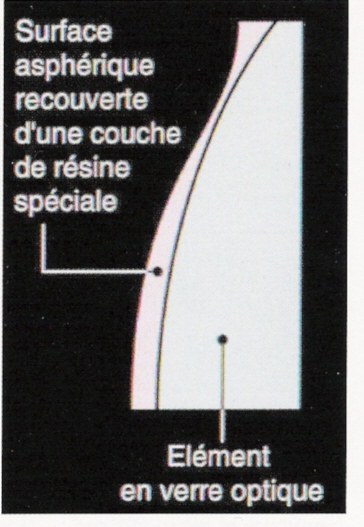Decrypter le nom d'un objectif photo
Claude Tauleigne - réponses photo - n°141 décembre 2003
Présentation
Il est souvent très difficile de s'y retrouver dans l'appellation d'un objectif.
Quels sont les sigles qui désignent sa qualité
et quels sont ceux qui renseignent sur
sa compatibilité avec les différents boîtiers de la marque ?
Et n'existe-t-il pas des lettres ou indications inutiles,
si ce n'est à allonger un nom déjà très complexe...

Généralités
Généralement les sigles et signes distinctifs qui composent le nom d'un objectif suivent une séquence
à peu près logique. On trouve d'abord, outre la marque, le type de monture
(qui renseigne sur les compatibilités mécaniques et électriques), les propriétés du système autofocus,
la gamme (pro, amateur...), la focale et l'ouverture puis divers renseignements sur
les propriétés des lentilles utilisées ou leur structure particulière et enfin le
reste... Bien entendu, chaque constructeur possède sa propre nomenclature et, marketing aidant,
certains sont plus loquaces que d'autres. Certains n'informent en effet jamais, dans le nom de
leurs optiques (ces renseignements sont toutefois précisés dans les fiches techniques), sur certaines
données. Impossible, dans un objectif Canon, par exemple, de savoir s'il dispose de verres spéciaux
à la seule lecture de son nom (il faut dire qu'ils en ont quasiment tous...). Idem chez Nikon qui ne
précise pas si un objectif comporte des lentilles asphériques.
Il faut bien dire que ces indications ne sont absolument pas utiles pour un photographe, pour qui
seul le résultat compte. Certaines marques indiquent donc simplement, pour donner une idée de la qualité
d'une optique, la gamme à laquelle elle appartient. Bien entendu, seule l'appartenance à la gamme
supérieure (professionnelle) est indiquée. Achèteriez-vous un objectif "FPQPBRC" (For Poor Quality Pictures,
But Really Cheap) ? La gamme pro se reconnaît souvent à un détail extérieur : plaque dorée, couronne de
couleur, finition granitée (ce qui permet de donner l'apparence pro à certains FPQPBRP), mais ces
considérations cosmétiques varient toutefois avec la "mode" tandis que les repères dans la dénomination
varient moins vite. Chez Canon, les objectifs pros (avec un liseré rouge) appartiennent à la série "L",
chez Minolta, ils sont "G", chez Sigma les optiques pour experts (avec finition granitée noire) sont "EX",
chez Tamron, les passionnés choisiront les optiques "SP" (comme Super Performances...) enfin chez Tokina,
les objectifs à couronne dorée sont "Pro"...
Compatibilité mécanique
Mais la première chose à vérifier est la compatibilité de la baïonnette de l'objectif (dont la forme
et le type sont toujours désignés dans le nom) avec la monture de son appareil. Car on ne monte pas
n'importe quelle optique sur n'importe quel boîtier, même si leur marque est identique. On citera,
par exemple et historiquement, le passage de la monture vissante au diamètre 39 mm à la baïonnette M
chez Leica (avec l'arrivée du M3). Plus récemment, certaines marques ont également choisi de modifier
radicalement leur baïonnette lors du passage à l'autofocus, ce qui leur a laissé une grande marge de
manœuvre dans la conception mécanique et optique de leurs futures optiques. C'est le choix adopté par
Canon (qui a abandonné la monture "FO" au profit de la "EF"), par Minolta ("MD" à "AF") et Contax
("MM" à "N"). Même si les possesseurs de systèmes complets ont évidemment grincé des dents à l'époque
(le changement de monture imposait un changement radical de tout leur fourre-tout pour accéder aux
nouvelles technologies), le choix s'est avérépayant. Car Nikon (baïonnette "F") et Pentax (baïonnette "K")
ont en revanche opté pour une compatibilité mécanique qui les a obligés à créer de multiples déclinaisons
de leur monture (voir l'encadré). Et parfois même à créer des objectifs totalement incompatibles avec
les plus anciens boîtiers : Nikon (avec les "AF-G") puis Pentax (avec les "FA-J") ont finalement
supprimé la bague de diaphragme manuelle de leurs optiques. Il semble que la compatibilité opto-mécanique
va - chez tous les constructeurs ayant un pied dans le reflex numérique - être mise à mal : les capteurs de
petite taille imposent cette entorse pour permettre des évolutionstions futures. Canon a ainsi débuté
la gamme des "EF-S" et Nikon celle des "DX". D'autres constructeurs se contentent d'indiquer une
optimisation optique pour les reflex numériques. Il s'agit des "DG Sigma et des "Di" chez Tamron.
Mise au point, motorisation et stabilisation
L'autre point qui intéresse en premier chef les phototographes est le type de motorisation de l'objectif.
De plus en plus d'optiques possèdent leur moteur intégré et certains d'entre eux sont plus performants
que d'autres, en termes de silence et de rapidité. C'est Canon qui a le premier, intégré des
moteurs "USM" (Ultra Sonic Motor) qui convertissent un champ électrique à haute fréquence en déplacement
mécanique des lentilles de manière quasi-instantannée et pratiquement sans aucun bruit. Deux types de moteurs
USM cohabitent dans la gamme Canon: le moteur circulaire (qui permet la retouche
manuelle du point en mode AF) et le micromoteur (qui ne permet pas cette retouche).
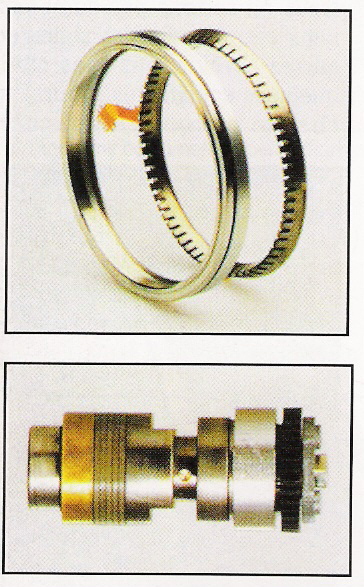 |
Les deux types de moteurs ultrasoniques utilisés dans
les objectifs Canon: moteur annulaire et micro-moteur (ne permettant pas la retouche manuelle du point).
|
Sigma a ensuite présenté ses moteurs "HSM" (Hyper Sonic Motor) puis Nikon ses
"SWM" (Silent Wave Motor, désignés par "AF-S" dans le nom de l'objectif).
Les Minolta "SSM" (Super Sonic Motor) viennent enfin d'arriver après
quelques années d'annonce.
Il est à noter que si la majorité des anciennes optiques manuelles effectuaient
la mise au point en déplaçant l'ensemble des lentilles, la plupart des objectifs
AF possèdent un système de mise au point interne ou "IF" (Internai - ou Inner
Focusing) : une partie seulement des lentilles se déplace pour effectuer la mise
au point (ce qui se traduit au passage par une modification de la focale...).
Ceci pour que les moteurs autofocus aient une masse de lentilles la plus faible
possible àdéplacer, réduisant ainsi la consommation électrique. Les fabricants
précisent parfois que cette mise au point interne s'effectue à l'aide du dernier
groupe optique: l'optique s'appelle alors "RF" (Rear Focusing) ou "IRF".
 |
|
Principe de la mise au point interne: seule une partie de l'ensemble des
lentilles se déplace pour focaliser sur un sujet à distance finie.
Document Tokina.
|
Sigma a
récemment remis au goût du jour la communication sur le fait que le guidage des
lentilles s'effectue souvent de manière linéaire à l'intérieur du fût, grâce à
une rampe hélicoïdale, d'où le suffixe "HF" (Helicoid Focusing) : la lentille
frontale ne tourne pas pendant la mise au point.
Autre point clef des optiques modernes : la stabilisation optique qui permet
de limiter les flous de bougé sur les images en compensant les mouvements du
photographe. Nikon a initié l'ajout de ce système dans un compact, avant que
Canon ne l'intègre le premier dans un objectif pour reflex 24x36. Ces systèmes
sont désignés par "IS" (Image Stabilizer chez Canon), "VR" (Vibration Reduction
chez Nikon) et "OS" (Optical Stabilizer chez Sigma - bientôt).
Structure optique
Le nom d'un objectif est surtout riche d'enseignement sur sa formule optique.
Le temps est révolu où celle-ci était - plus ou moins - révélée par un nom
générique comme "Isaron", "Xenar" et autres "Heliar" (bien qu'i! subsiste des
"Biogon", des "Planar" et des "Summicron"). Les renseignements fournis par la
dénomination d'un objectif concernent désormais surtout la composition de ses
verres, et notamment si certains d'entre eux permettent un traitement correctif
à l'aberration chromatique. Rappelons que l'aberration chromatique est un
phénomène lié à la nature dispersive du verre : les rayons rouges sont moins
déviés que les rayons bleus, ce qui réduit le piqué de l'image finale (en couleur
comme en noir & blanc). Pour limiter le phénomène, particulièrement sensible sur
les longues focales, on peut utiliser des verres spéciaux dont la dispersion est
réduite (verres à faible dispersion). Lorsque c'est le cas, on trouve les sigles
suivants sur les objectifs : "LD" (Low Dispersion), "ED" (Extra Low
Dispersion), "UD" (Ultra ..
Low Dispersion), "SD" ou "SLD" (Super Low Dispersion).
On attend toujours les "HD"
(Hyper Low Dispersion) avec impatience. Comme la nature de ces verres joue sur leur
indice de réfraction, Tamron emploie depuis peu "XR" (Extra Refractive). Un autre
type de verre permet de minimiser l'aberration chromatique: ceux qui sont à
dispersion anomale comme la fluorite (fluorine de calcium CaF2). Ces verres,
fragiles et chers, sont souvent désignés par "AD" (Anomalous Dispersion). Si l'on
pousse la correction chromatique plus loin üusqu'à l'éliminer pratiquement), on
obtient un objectif apochromatique, nommé "Apo" chez pratiquement tous les
constructeurs. La mention "Apo" sur un objectif n'est liée à aucune norme... et
bien des "Apo" ne sont donc que des "ED" améliorés. C'est pourquoi Leica (chez qui
la correction apochromatique correspond à des normes strictes, incluant par exemple
les rayons infrarouges) se bat pour "faire le ménage" dans cette appellation trop
galvaudée.
Autre phénomène désormais répandu : les lentilles asphériques (notées "AS" ou "Asph"
chez tous les constructeurs). Elles permettent de limiter une autre aberration
(sphérique) et corrigent également des phénomènes comme la distorsion.
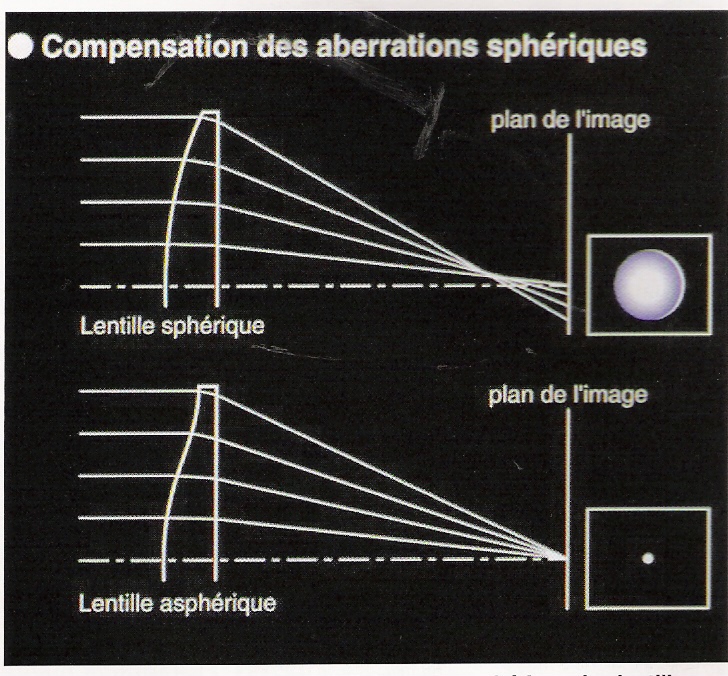 |
|
Une lentille asphérique compense l'aberration sphérique des lentilles, qui
conduit les rayons marginaux (passant par les bords de la lentille)
à converger plus près que les rayons passant par le centre. Elle permet
en outre de corriger la distorsion. Document Tamron
|
L'inconvénient est que ces lentilles sont très difficiles à usiner et la
quasi-totalité des lentilles asphériques est "hybride" : une surface asphérique en
matière synthétique est accolée à une lentille "sphérique" classique.
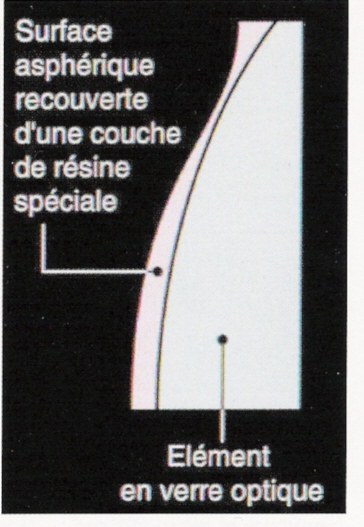 |
Lentille asphérique hybride: un élément en résine, accolé
à une lentille classique en verre, donne la forme asphérique souhaitée. Document Tamron.
|
Rien ne différencie, dans le nom des objectifs, une vraie lentille asphérique d'une
hybride... au grand dam d'opticiens comme Leica - encore - qui n'utilise que des
lentilles asphériques en verre (les lentilles asphériques du premier Noctilux de
50 mm subissaient un polissage final... à la main !). Signalons égaiement un
nouveau type de lentille, utilisé par Canon: les "DO" (Diffractive Optic),
utilisant le principe de la diffraction des réseaux à la place de la réfraction
du verre pour dévier les rayons lumineux.
Des sigles bien spécifiques
Dans un autre domaine, certains objectifs sont étudiés pour donner de "l'enveloppe"
aux images, rendu que certains photographes peuvent rechercher dans le domaine du
portrait. Ces objectifs sont désignés différemment selon les marques : "SF" (comme
Softfocus) chez Canon et Minolta, "Soft" chez Pentax. Chez Nikon, l'effet vaporeux
de l'image est réglable (et peut donc être annulé) grâce au système "DC" (Defocus
Control). Signalons aussi la version "STF" (Smooth Trans Focus) chez Minolta qui
possède un deuxième diaphragme sur un doublet de lentilles formant un dégradé
concentrique et qui permet d'estomper les zones hors profondeur de champ. D'autres
optiques permettent, comme avec une chambre, le contrôle de la perspective et de la
zone de profondeur de champ. A cet effet, leurs lentilles peuvent être décentrées
ou basculées par rapport à l'axe de la prise de vue. Bien entendu, ces mouvements
sont incompatibles avec toute transmission autofocus et leur mise au point est
manuelle, ce qui n'est pas un problème étant donné qu'ils seront toujours utilisés
sur pied, pour des photos réfléchies. Ils s'appellent "TS" (Tilt & Shift) chez
Canon, "Shift" chez Pentax et "PC" (Perspective Control) chez Leica, Nikon et
Zeiss. Signalons également les "Reflex" et autres "Miror" qui correspondent aux
objectifs catadioptriques des marques qui ont encore de telles optiques à leur
catalogue.
Nous ne serions pas complets dans cette jungle des sigles et autres abréviations
sans citer quelques spécificités propres à chaque marque. Ainsi chez
Canon, le "MP-E" (65 mm f:2,8) est un objectif macro à grossissement variable, tout
comme le "3x1x" chez Minolta. Chez Sigma, "DF" (Dual Focus) symbolise la présence
d'un système permettant de passer plus ou moins directement du mode AF en mise au
point manuelle et "UC" désigne les objectifs Ultra Compact. Amusons-nous un peu du
"Super" (comme Super, tout simplement) de chez Tamron. Chez Zeiss, le T* fait
référence au traitement de surface multicouche des lentilles (spécifique à Zeiss),
traitement parfois nommé "MC" (Multi Coated) sur les anciens objectifs des autres
marques.
Tableau récapitulatif
| Marque | Canon | Minolta | Nikon | Pentax | Sigma | Tamron | Tokina |
| Gamme Pro | L | G | - | - | EX | SP | - |
| Moteur Sonique | USM | SSM | (AF-)S | / | HSM | / | / |
| Stabilisateur | IS | / | VR | / | OS | / | / |
Verres à
Faible dispersion | US,S-UD | AD | ED | ED | SLD | AD,LD | SD |
| Lentille asphérique | AL | - | - | AL | Asph | ASL | As |
| Mise au point interne | I/R | - | IF | IF | IF,RF | IF | IF,IRF |
Optimisation ou
Destination numérique | (EF-)S | / | DX | / | DG | Di | / |
| Objectif Soft | SF | SF et STF | DC | Soft | / | / | / |
| Contrôle de la perspective | TS-E | / | PC | Shift | / | / | / |
| Autres | DO: Diffractive Optic | - | G: pas de bague de diaphragme | J: pas de bague de diaphragme | HL: Helicoid Focusing | - | - |
|
|
Compléments Nikon et Pentax